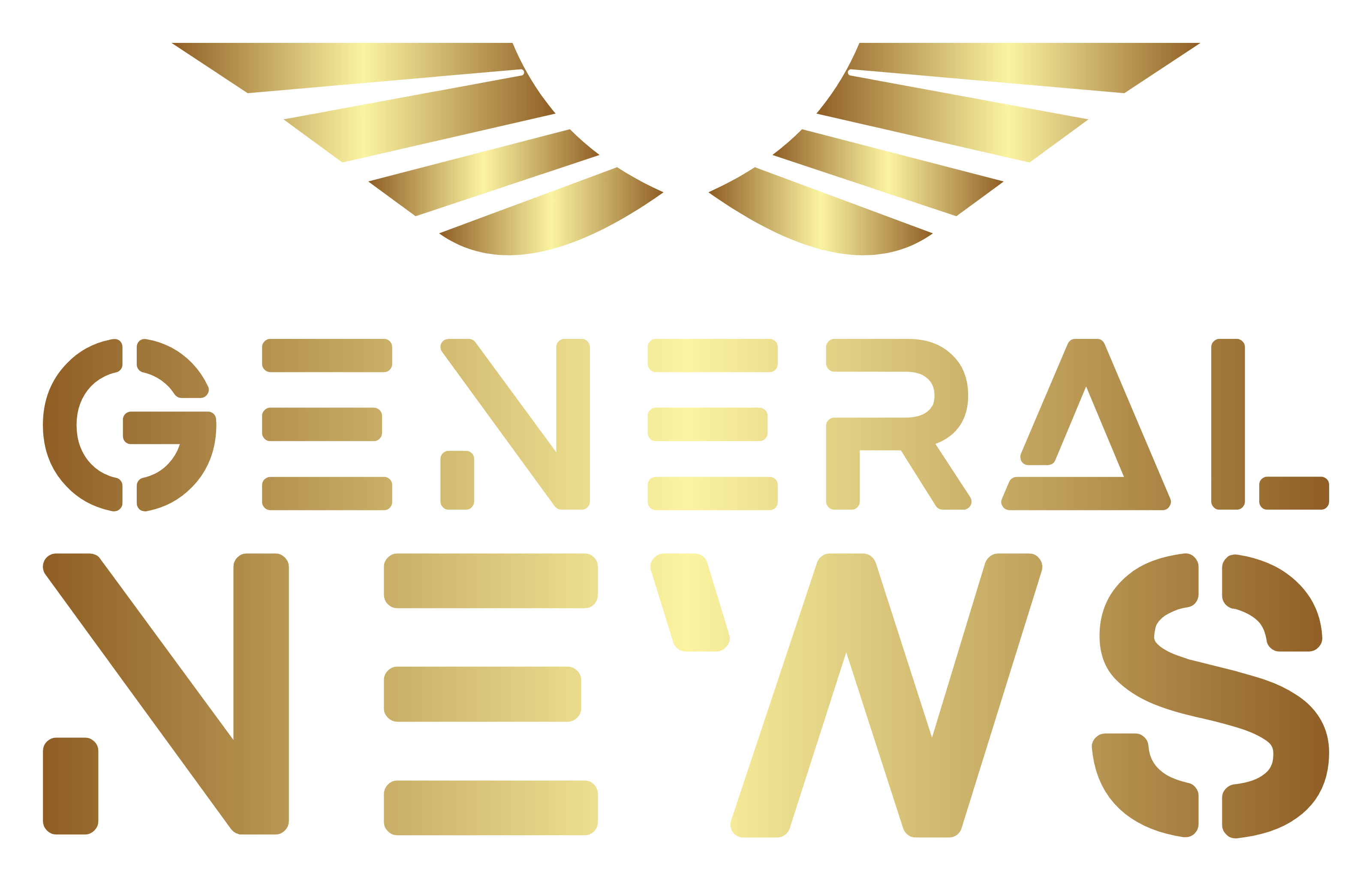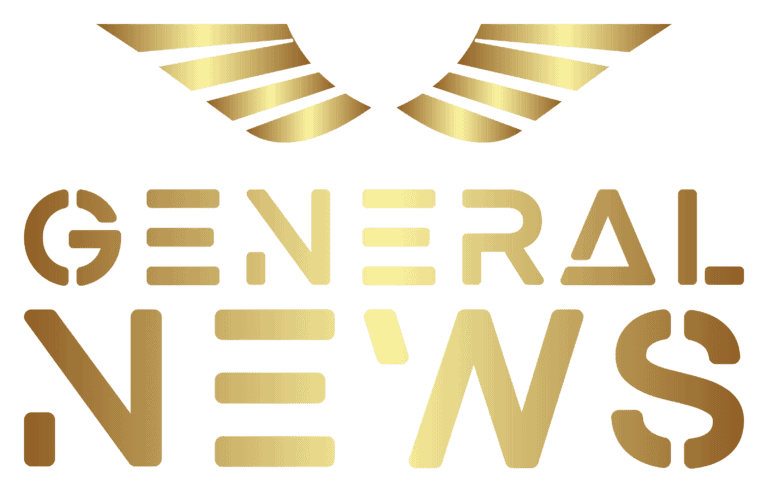Introduction à l'exposition haptique
La Galerie nationale de Prague possède une vaste collection de moulages d'œuvres médiévales. Plus d'une douzaine d'œuvres ont été sélectionnées parmi elles, illustrant la transformation stylistique de la forme sculpturale de la période romane au gothique tardif. La sélection montre clairement comment l'approche des sculpteurs dans la représentation des images religieuses et de la réalité quotidienne a changé au cours des siècles. La collection exposée présente des sculptures en pierre et des copies de sculptures. Les originaux de certaines de ces sculptures subsistent des siècles plus tard dans les lieux pour lesquels elles ont été créées. C'est le cas, par exemple, des portraits-bustes de la cathédrale Saint-Guy de Prague ou de la belle Madone de Plzeň. D'autres sont aujourd'hui visibles dans l'exposition de la galerie.
Introduction à la sculpture gothique
Le style gothique trouve ses racines en France et nous est parvenu indirectement, notamment via la Rhénanie au milieu du XIIIe siècle. Au début, la sculpture médiévale était étroitement liée à l'architecture. Les statues étaient placées à l'extérieur et à l'intérieur. Elles décoraient souvent les portails et les antichambres, tandis qu'à l'intérieur, elles étaient placées sur des consoles, des colonnes et des piliers, complétant ainsi la décoration des autels. Par la suite, les statues ont été de plus en plus utilisées à l'extérieur de l'architecture, ce qui est lié au changement de leur format et à la variété des matériaux utilisés. Outre les sculptures en pierre, généralement faites de calcaire ou de grès, de nombreuses sculptures en bois ont survécu. Dans les pays tchèques, le bois le plus souvent utilisé était celui du tilleul, et plus rarement celui des arbres fruitiers et des conifères. Les sculptures en bois, mais aussi certaines sculptures en pierre, recevaient généralement un traitement coloré - la polychromie.
Relief votif de la basilique Saint-Georges
Bohème, avant 1228
Moulage : plâtre patiné
Original : brume dorée, restes de polychromie d'origine, partie centrale h. 88 cm, l. 57 cm, ailes h. 66 cm, l. 27 cm
Le relief se compose de trois parties, très probablement reliées secondairement en un seul ensemble. Le panneau central est occupé par la figure la plus importante de la Vierge Marie, assise sur un trône. Elle tient l'Enfant Jésus sur ses genoux, représenté de profil, la main droite levée en signe de bénédiction. Dans les deux angles supérieurs, des anges munis d'encensoirs flottent sur des nuages. Ils posent une couronne sur la tête de Marie qui, comme les anges, est entourée d'une auréole. Une inscription latine gravée sur le cadre identifie les petits personnages agenouillés sous les marches du trône, aux pieds de Marie. À gauche, les mains jointes, se trouve la princesse Mlada, sœur du prince Boleslas II. Elle était abbesse du premier monastère bénédictin féminin de Saint-Georges au Château de Prague, fondé par son frère en 973. Sur le côté opposé se trouve une représentation de l'abbesse Berta en train de prier. Sur l'aile droite est agenouillé le roi Přemysl Otakar I, comme l'indique l'inscription conservée sur le bord du cadre, et sur l'aile opposée une religieuse en prière, probablement l'abbesse Agnès, demi-sœur du roi.
Madone de Prostějov
Maître de la Madone Michel - atelier
Prague ( ?), vers 1340
Moulage : plâtre patiné, tête de la Madone h. 32 cm
Original : bois de tilleul, restes de la polychromie d'origine,
h. 113,5 cm
La sculpture est attribuée à l'atelier d'un excellent sculpteur travaillant à Prague ou à Brno dans le deuxième quart du XIVe siècle. D'après l'une de ses œuvres les plus célèbres, il est appelé, à juste titre, le Maître de la Madone Michel. La Madone de Michel est exposée dans le cadre de l'exposition permanente d'art médiéval de la ville. La tête de la Madone de Prostějov exposée fait partie d'une sculpture de la Vierge Marie debout avec l'Enfant Jésus. Marie n'a pas de couronne, le voile à l'arrière couvre ses cheveux et ne tombe pas librement sur ses épaules, mais enveloppe toute sa poitrine. Les détails finement sculptés au sommet des mèches de cheveux ondulés ébouriffés sont frappants. Elles sont torsadées en plis profonds qui encadrent le visage. Un soupçon de sourire anime le visage aux yeux grands ouverts, au nez court et légèrement retroussé et au petit menton.
Madone franciscaine
Prague ( ?), après 1350
Fonte : résine époxy, polychrome
Original : bois de tilleul, polychrome postérieur, h. 134 cm
La statue ornait le cloître du monastère franciscain de Pilsen. La figure de la Vierge Marie est grande, allongée, légèrement penchée et légèrement en avant. Sur sa main droite est assis un enfant anormalement haut, dont la tête est presque au niveau de celle de Marie. L'enfant Jésus n'est pas vêtu et ses hanches sont recouvertes d'un voile. Il est représenté presque de profil et ses deux mains sont dirigées vers l'avant-bras gauche de Marie. Le symbole du pouvoir souverain du futur souverain illimité est la sphère que le Sauveur tient dans sa main gauche. Le geste vif de l'enfant rompt la profonde contemplation et une certaine rigidité. Le visage de Marie est encadré par de longues mèches de cheveux tressés de façon complexe, et sa tête non couronnée est couverte d'un voile. Le bas de sa robe droite est recouvert d'un manteau fixé à la poitrine par une agrafe. L'extrémité droite de la cape, drapée sur le bras, crée plusieurs plis très marqués qui perturbent le rythme fluide du vêtement.

Petr Parler
Cabane Svatovítská, 1378 - 1379
Fonte : résine époxy, patinée
Original : grès, 63 x 60 cm
L'estime dont jouissait l'architecte de la cathédrale Saint-Guy est attestée par l'inclusion de son portrait dans la galerie de portraits des membres de la famille royale sur le triforium de la cathédrale Saint-Guy. Le triforium est une galerie de style cathédral dans l'épaisseur du mur de l'église, ouverte vers l'intérieur et située sous les fenêtres et au-dessus des arcades du chœur et de la nef. Comme l'atteste l'inscription au-dessus du buste dans le triforium, Charles IV convoqua Peter Parléř, âgé de vingt-trois ans, à Prague et le désigna en 1356 comme bâtisseur de la cathédrale Saint-Guy. Sur le portrait, il présente un visage ovale aux joues légèrement creusées, un front haut et bombé et des cheveux rares, coupés court et peignés derrière les oreilles. Le regard, sans insister sur les paupières, suggère une profonde réflexion. La moustache sous le nez étroit et régulier est suivie d'une courte barbe sur un menton banal. Le bord replié du col crée un pli naturel en forme de cuvette sous le cou. Sur la poitrine se trouve un emblème magistral bien conservé : un bouclier de charbon de bois en pierre.
Charles IV.
Cabane de Svatovítská, 1375 - 1378
Fonte : résine époxy, patinée
Original : grès, 58 x 59 cm
Charles IV a été souvent représenté au IVe siècle. On retrouve son image dans les peintures murales, les panneaux et les livres, dans les mosaïques, dans l'orfèvrerie, sur les sceaux et les pièces de monnaie. Le portrait de Charles IV du triforium de la cathédrale Saint-Guy a été, comme d'autres bustes-portraits, réalisé grandeur nature, polychromé et accompagné d'un emblème. Les portraits des membres de la famille royale sont classés selon une hiérarchie stricte. Le buste de Charles IV occupe la place la plus honorable au milieu. Le roi a de grands yeux très éloignés les uns des autres. La paupière supérieure est soulignée par deux lignes fortes, la paupière inférieure est presque droite. La bouche légèrement ouverte sous le nez court et fort est encadrée par une moustache et une barbe sculptées. Les cheveux sont couverts sur les côtés par de longs et larges rubans se terminant par des franges. Ils recouvrent le bord relevé du col. Il s'agit d'un vestige de la mitre, coiffure liturgique.
Anna Svidnicka
Cabane de Svatovítská, 1375 - 1378
Moulage : plâtre patiné
Original : grès, 55 x 53 cm
La fille du duc Henri de Svídnice, la princesse Anne, âgée de 14 ans, devient la troisième épouse de Charles IV, alors âgé de 37 ans, le 27 mai 1353. Deux mois plus tard, elle est couronnée reine de Bohême à Prague et reine de Rome le 9 février 1354 à Aix-la-Chapelle. Le portrait d'Anna Svídnická est l'un des bustes les plus charmants du triforium. Le visage ovale sur un cou fin avec un front haut et large est encadré par de longues mèches de cheveux naturels qui tombent librement sur les épaules. Le sourire doux, les yeux joyeux, le petit nez étroit et le petit menton rappellent la beauté des madones du beau style naissant. La vie d'Anna Svidnicka s'est achevée prématurément. Elle meurt un an après la naissance de son fils Venceslas (né le 26 février 1361), l'héritier du trône, attendu par tous.
Console avec chien et chat
Cabane Svatovítská, 1370 - 1380
Moulage : plâtre patiné
Original : grès, 42 x 73 cm
L'architecture gothique était complétée par des motifs animaliers et grotesques fantaisistes. Le triforium extérieur de la cathédrale Saint-Guy présente de petits reliefs d'animaux sous les consoles : une lionne avec ses petits, un ours, un cheval, une licorne, un aigle, un chat, une tête de poule, et sur le triforium intérieur, un masque masculin ainsi qu'un chat et un chien luttant. La représentation d'un chat est associée à des significations à la fois positives et négatives au Moyen Âge. Le chien est une image de loyauté, mais aussi d'envie et de colère. Un relief de la cathédrale Saint-Guy montre un chat à gauche menacé par un chien attaquant à droite, les dents montées. Il est courbé en arc de cercle. Sa patte avant droite est offensée et sa patte gauche repose sur la tête du chien en guise de défense. Ses pattes arrière sont contre le corps de son agresseur. Le relief du chat et du chien, reproduit à la page suivante, est un exemple d'œuvre dans laquelle le sculpteur a montré son sens de la réalité de la vie ordinaire.
Le combat de Saint-Georges contre le dragon
Martin et Georges de Cluj, 1373
(actif dans le dernier tiers du 14ème siècle)
Moulage : plâtre patiné, h. 50 cm
Original : bronze au plomb, h. 196 cm, l. 177 cm
Le torse exposé du personnage de Saint-Georges, coulé en plâtre, provient d'une sculpture équestre en bronze de Saint-Georges combattant un dragon. Au XVIe siècle, la statue originale était placée sur la fontaine devant le monastère Saint-Georges et, à partir du XVIIIe siècle, dans la troisième cour du Château de Prague, où se trouve aujourd'hui une copie de la statue. Le moulage en plâtre ne représente que la partie supérieure de la figure du guerrier. Saint-Georges est complètement privé de son bras droit, le gauche se terminant par un coude. Il est vêtu de l'armure d'un chevalier médiéval, sa taille étroite est entourée d'une ceinture à boucle à laquelle était attachée une épée. Son visage est jeune, presque souriant et rêveur, seules les rides de son front se rejoignent en une sorte d'anneau. Les yeux sont de forme irrégulière avec des paupières supérieures légèrement tombantes. Le culte de Saint-Georges était très populaire au Moyen Âge. Selon la légende, ce célèbre chevalier serait né en Asie Mineure à la fin du IIIe siècle et aurait été martyrisé sous le règne de l'empereur Dioclétien.
Madone en lactation de Konopiště
Prague, vers 1370
Moulage : plâtre patiné
Original : bois de noyer, polychrome postérieur, h. 50,5 cm
Le motif de la Vierge Marie allaitant l'enfant Jésus avait une signification symbolique au Moyen Âge. Mais il représente aussi fidèlement l'image de l'amour maternel. La Vierge est assise sur un coussin, légèrement courbée, l'ourlet relevé de sa robe laissant apparaître la pointe de son pied gauche. De sa main gauche, elle serre amoureusement l'enfant contre elle, de sa main droite elle tient le sein auquel l'enfant Jésus boit avidement, et de sa jambe repliée, elle s'appuie légèrement sur les genoux de sa mère. La tête de la Vierge n'est pas couronnée et est légèrement inclinée vers la droite. Le visage est encadré par de longues boucles de cheveux ondulés. Son regard est pensif, comme s'il anticipait le triste sort de son enfant. Un large voile couvre le sommet de sa tête et tombe librement sur ses deux épaules. L'extrémité gauche du voile, plus longue, enveloppe le corps de l'enfant, tandis que l'extrémité droite, plus courte, forme une courbe gracieuse sur la poitrine. Le thème religieux est transformé en une représentation de la relation émotionnelle entre la mère et l'enfant. Comme la sculpture originale en bois de noyer, le moulage présente des dommages mineurs. Le nez de Marie, une partie du voile et un côté du coussin ont été insultés.
Tympan du portail nord de l'église Notre-Dame devant Týn
Prague, vers 1380
Moulage : plâtre patiné, détail du segment supérieur droit du Combat des démons avec un ange pour l'âme de la canaille, h. 95 cm, l. 137 cm
Original : opuka, haut-relief, entier h. 232 cm, l. 302,5 cm
Le tympan de l'église de la Vierge Marie devant Týn à Prague est un monument important du règne de Venceslas IV. Il se compose de cinq panneaux en relief représentant des scènes de la Passion. Le fragment exposé de la Lutte du diable pour l'âme du vaurien n'en est qu'une petite partie. Les démons s'emparent de l'âme d'un brigand endurci. Trois monstres à la tête d'animal féroce et au sourire repoussant entourent le personnage qui se bat à mort. Le démon de droite saisit fermement le bras et la jambe gauches du malheureux, tandis que l'autre s'empare de sa main droite et de sa tête tordue vers l'arrière. Le troisième tient fermement la plante du pied droit du méchant. La scène de lutte est le point culminant de la décoration du tympan. Le mouvement réfléchi domine l'ensemble de la composition. À l'origine, ce relief était également polychrome.
Madone de Pilsen
Prague, 1384 (peu avant 1384)
Moulage : plâtre patiné
Original : opuka, polychrome original, h. 125 cm
L'une des plus célèbres statues mariales vénérées de la période du beau style a été créée à Prague pour l'autel principal de l'église Saint-Barthélemy à Pilsen. La Vierge Marie est debout sur un socle bas, tenant l'enfant Jésus nu en diagonale devant elle. Les doigts de la main gauche reposent naturellement sur le corps de l'enfant. La figure de la Vierge est en mouvement, de travers, le poids du corps reposant sur la jambe gauche, tandis que la jambe droite libre est sensiblement pliée. Légèrement inclinée vers l'épaule, la tête non couronnée se tourne vers l'enfant Jésus avec un doux sourire et des yeux comme rêveurs. L'enfant se détourne de sa mère et son regard est dirigé vers le spectateur. La pomme qu'il tient à deux mains est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, désignant Jésus comme le futur rédempteur de l'humanité du péché originel. Le manteau de la Vierge, qui couvre la partie inférieure de son vêtement, est légèrement ouvert et fermé par un fermoir. Le bord du manteau, drapé sur le bras droit, forme une riche collerette en cascade qui tombe librement en plis tubulaires.
Le Christ souffrant sur les nuages
Bohême, après 1475
Moulage : plâtre patiné
Original : bois de tilleul, polychrome postérieur, h. 72 cm
Le visage du Fils de Dieu est plein de souffrance. Sur sa tête se trouve une couronne d'épines, partiellement abîmée. Les paupières supérieures bombées donnent une expression mélancolique au regard vers le bas. De même, la dépression entre les arcades sourcilières saillantes et les coins de la bouche tombants accentue la douleur du Christ. Les cheveux, modelés en ondulations soignées, s'écoulent librement sur les épaules. La mèche droite est abîmée. Avec le pouce de la main droite, Jésus montre la plaie ouverte et lève la main gauche dans un geste de prière et d'intercession. La demi-figure est placée dans un bandeau de nuages stylisés, car le Christ reviendra sur les nuages lors de sa seconde venue sur terre. Jésus montre ses blessures à Dieu le Père pour apaiser sa colère contre l'humanité corrompue, tout en agissant en tant que Sauveur et futur juge des péchés des vivants et des morts.
ngprague.cz/gnews.cz-jav